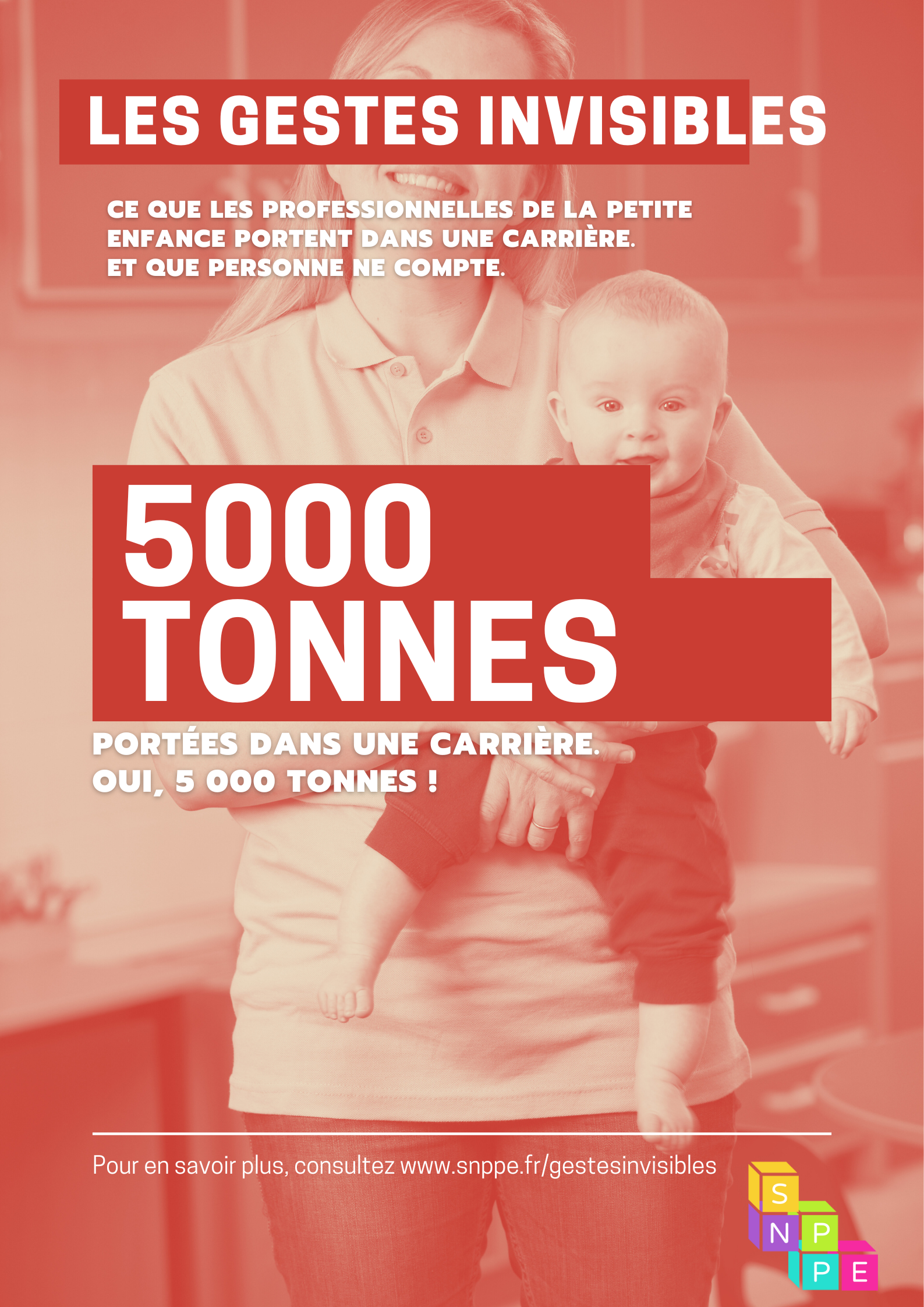Problème de chauffage : comment réagir dans la petite enfance ?
Après plusieurs jours de fermeture ou de congés pendant les fêtes, certain·es d’entre vous risquent de découvrir des locaux insuffisamment chauffés, voire gelés, suite à une panne passée inaperçue.
Que vous travailliez en EAJE, comme assistante maternelle ou comme garde d’enfants à domicile : que faire ? Sur quoi s’appuyer pour alerter et protéger les enfants ?
🚨 Situation d’urgence : les locaux sont trop froids
Évaluer la situation
Dès votre arrivée (ou dès le constat), relevez la température des espaces d’accueil.
Repères de température :
- L’arrêté du 31 août 2021 (annexe 1, II.4.1) recommande une température ambiante entre 18°C et 22°C dans les espaces d’accueil des enfants en EAJE
- Le ministère de la Santé recommande de maintenir la température ambiante à un niveau convenable, minimum 19°C y compris dans les chambres
- L’INRS considère qu’en dessous de 18°C, l’environnement de travail est « froid »
Signes d’alerte :
- Température relevée inférieure à 16°C dans les espaces d’accueil
- Sensation de froid marquée
- Sol glacé
- Condensation ou givre sur les fenêtres intérieures
Alerter immédiatement
Le circuit d’alerte dépend de votre situation professionnelle :
En EAJE :
- Votre direction / gestionnaire (appel + écrit)
- Le service technique pour intervention d’urgence
- La PMI si la situation compromet l’accueil
Assistante maternelle (à domicile ou en MAM) :
- Prévenez les parents employeurs par écrit (SMS, mail) dès le constat
- Contactez la PMI de votre secteur
- Pour une MAM : alertez également le propriétaire ou gestionnaire des locaux
Garde d’enfants à domicile :
- Prévenez immédiatement les parents employeurs (appel + écrit)
- Ne restez pas dans un logement dangereux : proposez de vous rendre dans un lieu adapté avec l’accord des parents
Dans tous les cas : gardez une trace écrite (heure, température relevée, personnes prévenues).
⚖️ Vos arguments réglementaires
Le Code du travail protège tous les salariés
Article R. 4223-13 : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. »
Article L. 4121-1 : L’employeur a une obligation générale de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur·ses.
Article R. 4223-15 : L’employeur prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleur·ses contre le froid.
⚠️ Ces articles s’appliquent à tous les employeurs, y compris les particuliers employeurs.
Spécificités selon votre mode d’exercice
En EAJE : L’arrêté du 31 août 2021 (référentiel national) prévoit en annexe 1 :
Annexe II.4.1 : « Hors période de forte chaleur et canicules, telles que définies par Météo-France, il est recommandé que la température ambiante dans les espaces d’accueil des enfants soit comprise entre 18°C et 22°C. »
Annexe 1 II.4.2 : Les dispositifs de chauffage doivent être sécurisés (température de contact < 60°C ou dispositifs inaccessibles aux enfants)
Assistante maternelle agréée : L’article L. 421-3 du Code de l’action sociale et des familles conditionne l’agrément à des conditions d’accueil garantissant « la santé, la sécurité et l’épanouissement » des enfants. Un logement non chauffé peut justifier une suspension temporaire de l’accueil et doit être signalé à la PMI.
L’article R. 421-3 du CASF précise que le référentiel fixant les critères d’agrément comprend notamment « la sécurité, la santé et l’épanouissement du jeune enfant » ainsi que la « maîtrise de langue française » permettant le suivi médical de l’enfant.
Garde d’enfants à domicile : L’employeur (le parent) doit garantir un environnement de travail sûr dans son propre domicile. L’article L. 4121-1 s’applique pleinement.
Convention collective du particulier employeur
La CCN de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239) prévoit :
Article 7 – Santé et sécurité au travail : « L’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié. L’employeur met en œuvre les mesures de protection utiles pour préserver la santé et la sécurité du salarié. »
Article 67 (assistantes maternelles) : Le logement de l’assistante maternelle doit permettre un accueil dans des conditions préservant « la santé, la sécurité et l’épanouissement de l’enfant ».
⚠️ Limites réglementaires : Si l’arrêté du 31 août 2021 recommande une température de 18-22°C en EAJE, ce seuil n’est pas juridiquement contraignant. Pour les assistantes maternelles et gardes à domicile, aucune température minimale n’est fixée.
👶 L’argument décisif : la vulnérabilité des jeunes enfants
Ce que dit le ministère de la Santé
Le ministère de la Santé identifie explicitement les nouveau-nés et les nourrissons parmi les personnes à risque face au grand froid :
« Leur capacité d’adaptation aux changements de température n’est pas aussi performante que celle d’un enfant ou d’un adulte pour lutter contre le froid. De plus, le très jeune enfant n’a pas d’activité physique lui permettant de se réchauffer et il ne peut exprimer qu’il a froid. »
Recommandations officielles en cas de sortie obligatoire :
- Couvrir le bébé, particulièrement la tête (bonnet) et les extrémités (mains, oreilles, pieds)
- Éviter les porte-bébés type sac à dos (risque de compression des membres et de gelures)
- Transporter l’enfant libre de ses mouvements pour qu’il puisse bouger et se réchauffer
- Multiplier les épaisseurs plutôt qu’un seul vêtement épais
- Donner à boire régulièrement
Le ministère recommande : « Sauf nécessité impérative, évitez de sortir votre nourrisson en période de grand froid. »
Données de santé publique
L’OMS définit l’hypothermie chez le nourrisson comme une température corporelle inférieure à 36,5°C.
Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables car :
- Leur système de thermorégulation est immature
- Leur rapport surface corporelle/poids est élevé (ils perdent plus vite leur chaleur)
- Ils ne peuvent pas exprimer qu’ils ont froid ni se couvrir seuls
- Les signes d’hypothermie (pâleur, somnolence, refus de s’alimenter) peuvent passer inaperçus
Un enfant qui a froid ne le dit pas : il pleure, refuse de manger, devient apathique.
✅ Les mesures à prendre selon votre situation
En EAJE
Exigez de votre employeur :
- Chauffage d’appoint sécurisé (attention au risque de brûlure – article II.4.2 du référentiel)
- Intervention technique dans les plus brefs délais
- Réduction ou fermeture temporaire si la température ne peut être rétablie rapidement
Assistante maternelle
Chez vous :
- Prévenez immédiatement les parents et proposez de reporter l’accueil
- Contactez la PMI pour les informer de la situation
- Ne forcez pas l’accueil dans des conditions dangereuses : vous engagez votre responsabilité
- Faites intervenir un chauffagiste en urgence – les frais peuvent être déclarés (entretien du logement professionnel)
En MAM :
- Alertez le gestionnaire/propriétaire des locaux
- Déclenchez une intervention technique d’urgence
- Informez la PMI et les parents de tous les enfants accueillis
- Fermez temporairement si nécessaire
Garde d’enfants à domicile
Au domicile des parents :
- Alertez immédiatement les parents employeurs : c’est leur responsabilité de garantir un environnement de travail adapté
- Ne restez pas dans un logement présentant un danger
- Proposez une solution : se rendre chez un proche, dans un lieu public chauffé
- Refusez de mettre l’enfant en danger : vous pouvez invoquer votre obligation de protection
Dans tous les cas : ce qui est interdit
Ne jamais utiliser pour chauffer :
- Chauffages à combustion non raccordés (risque de monoxyde de carbone)
- Poêles à pétrole, braseros, réchauds de camping
- Four allumé porte ouverte
Le risque de monoxyde de carbone est mortel et invisible.
🛑 Peut-on refuser de travailler ?
En EAJE (salarié d’une structure)
Le droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) s’applique en cas de danger grave et imminent. Cependant, la circulaire DRT n°93/15 précise qu’il ne peut s’exercer si le risque concerne les usagers.
En pratique : privilégiez l’alerte collective dès l’ouverture si vous constatez le dysfonctionnement (direction, CSE, inspection du travail, PMI).
Assistante maternelle
Vous n’êtes pas tenue d’accueillir les enfants dans des conditions qui compromettent leur sécurité. Prévenez les parents et la PMI, proposez le report de l’accueil.
Attention : une absence prolongée sans solution peut poser un problème contractuel. Communiquez, proposez des alternatives, documentez votre bonne foi.
Garde d’enfants à domicile
Vous pouvez refuser de travailler si les conditions présentent un danger pour vous ou l’enfant. L’employeur (parent) a l’obligation de fournir un environnement de travail sûr.
En pratique : alertez, proposez des solutions alternatives, ne mettez jamais l’enfant en danger.
📝 Modèles de signalement
Pour les salariés d’EAJE
Madame, Monsieur,
Je vous informe qu’à mon arrivée ce jour [date] à [heure], j’ai constaté une température de [X]°C dans les espaces d’accueil des enfants de [nom de la structure].
Je vous rappelle que l’arrêté du 31 août 2021 (annexe 1, article II.4.1) recommande une température ambiante comprise entre 18°C et 22°C dans les espaces d’accueil. Par ailleurs, l’article R. 4223-13 du Code du travail impose que les locaux de travail soient chauffés à une température convenable.
Compte tenu de la particulière vulnérabilité des jeunes enfants face au froid, cette situation présente un risque pour leur santé et celle des professionnel·les.
Je vous demande de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais.
[Signature]
Pour les assistantes maternelles (aux parents)
Bonjour,
Je vous informe que je rencontre un problème de chauffage à mon domicile / à la MAM. La température relevée ce matin est de [X]°C, ce qui ne permet pas d’accueillir [prénom de l’enfant] dans des conditions de sécurité.
Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au froid (capacités de thermorégulation immatures). Par précaution, je vous propose de reporter l’accueil jusqu’au rétablissement du chauffage.
Une intervention technique est prévue [préciser si possible]. Je vous tiendrai informé·e de l’évolution de la situation.
Je reste disponible pour en échanger.
[Signature]
Pour les gardes d’enfants à domicile (aux parents employeurs)
Bonjour,
Je vous informe qu’à mon arrivée ce jour à [heure], j’ai constaté une température de [X]°C dans le logement.
Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit garantir un environnement de travail préservant la santé et la sécurité du salarié. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au froid.
Dans l’attente d’une intervention technique, je vous propose [solution alternative : me rendre chez X, dans un lieu adapté, etc.]. Merci de me confirmer la marche à suivre.
[Signature]
📣 Et maintenant ?
🛑 Une protection réglementaire insuffisante
Contrairement aux fortes chaleurs (plan ORSEC canicule), il n’existe aucun dispositif d’alerte équivalent pour le froid dans les modes d’accueil de la petite enfance.
En EAJE, l’arrêté du 31 août 2021 recommande une température de 18-22°C, mais ce seuil n’est pas contraignant. Pour les assistantes maternelles et gardes à domicile, aucune température minimale n’est même recommandée.
👶 Des enfants doublement vulnérables
Les nourrissons et jeunes enfants :
- Sont physiologiquement vulnérables au froid
- Dépendent entièrement des adultes pour leur protection
- Sont accueillis par des professionnel·les dont les moyens sont souvent contraints
✊ Mobilisons-nous avec le SNPPE
Quel que soit votre mode d’exercice, vous avez des droits.
- Pour faire reconnaître les risques liés au froid comme un enjeu de santé au travail
- Pour exiger des conditions d’accueil et de travail adaptées
- Pour alerter si votre employeur (structure ou particulier) ne prend pas ses responsabilités
- Pour faire évoluer la réglementation vers une meilleure protection des enfants et des professionnel·les
📚 Ressources
Textes réglementaires – Code du travail
- Article R. 4223-13 – Obligation de chauffage
- Article L. 4121-1 – Obligation générale de sécurité
- Article R. 4223-15 – Protection contre le froid
Textes réglementaires – Petite enfance
- Article L. 214-1-1 du CASF – Principes fondamentaux de l’accueil du jeune enfant
- Arrêté du 31 août 2021 – Référentiel national EAJE
- Article L. 421-3 du CASF – Conditions d’agrément des assistantes maternelles
- Article R. 421-3 du CASF – Référentiel d’agrément
Convention collective
Ressources institutionnelles
- Grand froid : information du public – Ministère de la Santé (recommandations officielles nourrissons)
- Risques sanitaires liés au froid – Ministère de la Santé
- Travail au froid – Réglementation – INRS
📞 Contacts utiles
- 115 – SAMU social (signalement personnes en danger)
- 15 – SAMU (urgence médicale)
- Inspection du travail de votre département
- PMI de votre secteur
- Relais Petite Enfance (ex-RAM) de votre territoire
- SNPPE : contact@snppe.fr